- Cartographie animée: les violences au Mali de juillet 2011 à février 2016
- CARTE. Les événements de violence au Mali de janvier à février 2016.
- CARTE. Les événements de violence au Mali de septembre à décembre 2015.
- ANALYSE. Vacances gouvernementales et prise d'otage au Mali
- ANALYSE. Les groupes armés dans le gouvernement et la tenue des élections locales
DRAME. La douleur d’une mère d’Echirolles
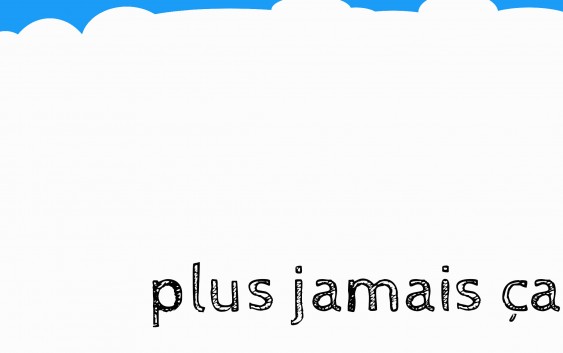
Matthieu Damian. Le 28 septembre 2012, à Echirolles, dans la banlieue grenobloise, deux jeunes étudiants sont assassinés par une bandes de jeunes. La mère d’un des deux enfants, Aurélie Monkam Noubissi, décide, un an après le drame, de revenir sur la façon avec laquelle elle a vécu ce drame et ce qu’elle en pense.
Un fils sans problème, ouvert aux autres et titulaire d’une licence professionnelle
Elle raconte l’enfance de son fils, à la Villeneuve d’Echirolles, où elle a vu, en quelques années, la qualité de vie se dégrader de façon nette. Elle raconte la conversion à l’islam de son fils alors qu’elle est chrétienne. A cet égard, son livre est imprégné de références bibliques ou religieuses. Elle peut écrire à ce sujet « Tu vois Kévin, ce que j’apprécie dans ton islam, c’est qu’il t’élève, te fait grandir. Loin de t’enfermer, il t’ouvre aux autres ; l’islam que tu pratiques reconnaît l’autre dans ce qu’il est et ne cherche pas nécessairement à le convertir, mais à instaurer une relation de partage. Je me retrouve bien, comme chrétienne, dans cette relation. » (p20)
Elle souligne une enfance sans problème d’un fils qui s’apprêtait à finir des études au niveau Master. Elle cite de nombreux témoignages, à la fin de son ouvrage, qui mettent en avant les qualités humaines de Kevin.
Camerounaise en France
Elle parle de son enfance au Cameroun, du fait qu’elle n’y soit pas revenue après avoir accompli ses études en France, et de sa mère restée sur place. Elle déplore le peu de progrès faits par ce pays depuis l’indépendance et la corruption endémique qui y prévaut.
S’agissant de son « assimilation« , elle écrit « Je suis obligée d’avoir quelques connaissances sur Céline, Châteaubriand, Maupassant, Sartre et Camus… mais pratiquement aucun de mes collègues ou des membres de mon entourage occidental ne sait qui sont Camara Laye, Léopold Sédar Senghor, Patrice Lumumba, Cheikh Hamidou Kane, Amadou Hampâté Bâ, Wole Soyinka, Cheikh Anta Diop… Ils connaissent à peine Aimé Césaire ou Frantz Fanon. Et je n’évoque même pas les écrivains ou héros de mon pays, tels que Félix Moumié, Ernest Ouandié ou Mongo Beti… N’est-ce pas là une forme de colonisation ou de servitude culturelle et mentale ?« (p64)
Elle s’interroge : « Comment peut-on définir un parcours d’intégration ? Si l’on veut simplifier, on peut dire qu’il s’agit de nous conformer aux règles du pays qui nous accueille, qui assure notre formation professionnelle, nous permet de nous émanciper. Nous y sommes devenus des adultes matures et responsables, nous avons éduqué nos enfants dans le respect des règles de la nation, nous nous sommes conformés, sans esprit vindicatif, je veux dire sans recourir à la posture de certains qui pensent que la France est redevable à ses anciennes colonies et que ce n’est qu’un juste retour des choses ; par cette attitude, nous témoignons d’une forme de reconnaissance. » (pp.60-1).
Une pédiâtre qui insiste légitimement sur le rôle de l’éducation
Elle intitule un chapitre « A propos d’éducation et de comportements violents » et cite Alain Braconnier : « éduquer, c’est donner les moyens d’exister, donner confiance et avoir confiance. » Elle fait ensuite le distinguo entre l’autoritarisme qui écrase l’individu et l’autorité qui l’élève, l’amène à s’accomplir en l’humanité (p67). Elle est d’autant plus légitime à intervenir sur ce sujet qu’elle est pédiâtre. A cet égard, Agnès Hugonin, vice-présidente de l’Ecole de la paix participera à une table-ronde, le 16 mai prochain, sur les moyens de prévenir la violence dès la petite-enfance. Mme Monkam Noubissi fait partie du comité d’organisation.
L’amélioration de la situation dans les quartiers populaires passe par une action politique
Elle cite ce propos d’une habitante de la place des Géants qui dit, deux jours après le drame : « Cela fait quinze ans qu’on nous dit la même chose, et rien ne change ! Cela arrange tout le monde d’avoir un quartier « ghetto » ; la Villeneuve de Grenoble est un nid à subvention, et on ne voit jamais le résultat du travail des associations ! Et on va nous enlever le marché, les assistantes sociales ! » (pp.76-7). Cela peut interpeller une association comme l’Ecole de la paix qui intervient précisément dans ce territoire. Cependant, si nous faisons notre travail de prévention de la violence et de promotion de la citoyenneté avec beaucoup de conviction, nous ne pouvons lutter contre le chômage, l’économie parallèle et les situations sociales compliquées qui prévalent dans ce quartier. Le vivre ensemble est à la fois l’affaire de tous et aussi une question éminemment politique : que faisons-nous des ressources que la société produit et comment mieux répartir celles-ci ? A cet égard, Aurélie Monkam Noubissi écrit : « La rancoeur intériorisée au plus profond d’un individu, parce qu’il est en permanence frustré – de ne pas pouvoir payer son loyer, de ne pas trouver de travail, de naviguer de petit boulot en petit boulot, de ne pas pouvoir se projeter dans le futur en raison de la grande précarité – n’est-ce pas là une forme de violence qui crée un climat de tension dans certaines zones urbaines ? » (p90).
Cette interrogation se double d’une question morale : quelle éducation voulons-nous promouvoir ? Si celle-ci est seulement axée sur des savoirs ou des savoirs-faires, elle manque une dimension essentielle : le savoir-être… Aurélie Monkam Noubissi a son avis : « Je crois que le « civisme » devrait être naturellement distillé à chaque instant des apprentissages, cela pourrait contribuer à donner du sens » (p76).
Le rôle des citoyens organisés
Comme lui a dit un jour une amie psychiatre, la question du « pourquoi » ne l’intéresse pas dans ses thérapies. Ce qui préoccupe celle-ci, c’est le « qu’est-ce que j’en fais ? » (p113). Aurélie Monkam Noubissi cherche à transformer son énergie négative et à la convertir au service d’une société meilleure. Elle sait cependant qu’elle ne pourra rien seule. Dès lors, elle cite quelques pistes d’action. Tout d’abord, elle souhaite créer un « fonds de dotation » pour que la mémoire de Sofiane et Kévin survive « avec une vraie mission orientée vers les jeunes, et surtout ceux qui sont exclus du système scolaire. (…) Les modalités de la création de cette fondation restent à définir » (p87). Elle revient sur ce sujet en indiquant : « Il s’agirait de créer, dès le
primaire, des aides au travail scolaire, afin que la motivation pour l’école ne faiblisse pas, puis d’orienter véritablement l’élève vers la formation (CAP, BEP, Compagnons du devoir, etc) » (p157).
Ensuite, elle rappelle la création d’un collectif « Marche blanche » qui a pour objectifs :
– de faire participer tous les habitants à la vie de leur quartier ;
– de créer des groupes de travail et de pilotage pour recenser les besoins et les présenter aux autorités ;
– de créer des liens avec les autres intervenants de la cité : police, pompiers, écoles, centres sportifs et sociaux ;
– de participer activement à la mise en place de la ZSP (Zone de sécurité prioritaire). (p92)
Elle met en valeur le fait que le collectif insiste sur le renforcement de la police de proximité, qui travaille au plus près des habitants, qui a une connaissance du terrain et qui agit en lien avec les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
Le collectif défend le fait qu’il est très important d’intensifier tout ce qui contribue à lutter contre l’échec scolaire, qui coûte très cher à la société ; donner à s’occuper à ces jeunes « qui tiennent les murs, qui se marginalisent, est une priorité » (p93). Elle souligne que le collectif doit « s’appuyer sur les initiatives existantes, comme l’Ecole de la paix, le programme Parler bambin (…) » (p94). Elle rappelle l’initiative prise par Latifa, la maman d’Imad Ibn Ziaten, soldat français assassiné à Toulouse en 2011 qui a créé une association « Imad pour la jeunesse et la paix » qui va dans le même sens.
Envisager la paix autrement ?
Nous apprécions la remise en cause de la justice telle que nous la connaissons actuellement. Elle dit ainsi qu’elle s’intéresse à la « justice restaurative : sans exclure la notion de sanction, elle laisse une grande place au versant réhabilitation, resocialisation, réinsertion des infracteurs, ce qui est particulièrement important quand il s’agit de jeunes ou de mineurs » (p157).
Elle cite enfin une lettre de Nabil et Pierre, jeunes parents trentenaires habitant l’agglomération grenobloise qui lui écrivent notamment : « Nous pensons que différents facteurs ont joué dans la prise de décision de ces jeunes meurtriers d’aller assassiner deux jeunes semblables. Le phénomène de groupe, l’influence des meneurs sur les suiveurs, la peur du ridicule et du rejet lorsqu’on ne suit pas la bande, la réputation au retour dans le quartier, le fait de se donner une image de dur afin d’affronter les autres ou de ressembler à certains modèles, sont sûrement des facteurs qui ont facilité le passage à l’acte.
En outre, les modèles proposés à nos jeunes sont aussi responsables : par exemple, les films glorifiant la réussite par la violence (du type Scarface, typique du genre qui influence les jeunes de quartier). Dans la musique aussi, hélas ! La surmédiatisation du « gangsta rap », l’apologie de la violence des ghettos américains ont créé des axiologies qui empêchent les jeunes de réfléchir normalement. Ce que nous voulons dire, c’est que les productions de la société dans laquelle nous vivons, la culture du « moi je », du « tout de suite et maintenant » de l’individualisme,
de l’enfant roi, de la réussite à tout prix, et parallèlement l’explosion des valeurs traditionnelles ont installé des modèles de pensée qui ont sûrement été des déclics ou des facilitateurs du passage à l’acte » (p187).
Un livre à recommander pour les pistes qu’il propose et pour la force de caractère d’une femme qui, par amour pour son fils, choisit le chemin de la résolution positive des conflits et non celui de la haine…
Lire: Aurélie MONKAM NOUBISSI, Le ventre arraché, Editions Bayard, Paris, 2014
Découvrir l’interview sur Francebleue ici
